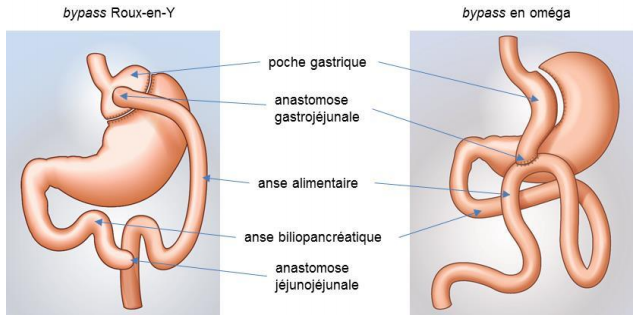Il est bien connu que les personnes qui travaillent de nuit ou qui voyagent souvent d’un fuseau horaire à l’autre ont une plus grande tendance à l’embonpoint et aux troubles d’inflammation intestinale.
Des chercheurs, dont les travaux sont publiés en septembre dans la revue scientifique Nature, ont découvert que la fonction d’un groupe de cellules immunitaires, dont on sait qu’elles contribuent fortement à la santé intestinale, est directement contrôlée par l’horloge circadienne du cerveau.
« Le manque ou la perturbation des habitudes de sommeil peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé, entraînant une panoplie de maladies qui ont souvent une composante immunitaire, comme les maladies inflammatoires de l’intestin
», explique Henrique Veiga-Fernandes du Champalimaud Centre for the Unknown (Lisbonne, Portugal).
Pour comprendre pourquoi cela se produit, le chercheur et son équipe ont commencé par vérifier si les cellules immunitaires de l’intestin sont influencées par l’horloge circadienne.
Presque toutes les cellules du corps ont un mécanisme génétique interne qui suit un rythme circadien au moyen de l’expression de gènes dits « de l’horloge ». Ces gènes fonctionnent comme de petites horloges qui informent les cellules de l’heure de la journée et aident ainsi les organes et les systèmes constitués par les cellules, à anticiper ce qui va se passer, par exemple si c’est le moment de manger ou de dormir.
Même si ces horloges cellulaires sont autonomes, elles doivent être synchronisées afin de s’assurer que « tout le monde est sur la même longueur d’onde ». « Les cellules à l’intérieur du corps n’ont pas d’information directe sur la lumière extérieure
», souligne le chercheur. « Le travail de l’horloge centrale du cerveau, qui reçoit des informations directes sur la lumière du jour, est de synchroniser toutes ces petites horloges à l’intérieur du corps
».
Parmi la variété de cellules immunitaires présentes dans l’intestin, l’équipe a découvert que les lymphoïdes innées de type 3 (ILC3) sont particulièrement sensibles aux perturbations de leurs gènes de l’horloge. « Ces cellules remplissent des fonctions importantes dans l’intestin : elles combattent les infections, contrôlent l’intégrité de l’épithélium intestinal et contribuent à la régulation de l’absorption des lipides
», explique le chercheur.
« Lorsque nous avons perturbé les horloges de ces cellules, nous avons constaté que leur nombre dans l’intestin était considérablement réduit. Cela a entraîné une inflammation sévère, une brèche dans la barrière intestinale et une augmentation de l’accumulation des graisses.
»
Ces résultats robustes ont poussé l’équipe à étudier pourquoi le nombre de ces cellules dans l’intestin était si fortement affecté par l’horloge du cerveau.
Lorsque l’équipe a analysé comment la perturbation de l’horloge du cerveau a influencé l’expression de différents gènes dans les ILC3, elle a découvert qu’il en résultait un problème très spécifique : le « code postal moléculaire » était manquant ! Pour se localiser dans l’intestin, les ILC3 ont besoin d’exprimer une protéine sur leur membrane qui fonctionne comme un code postal moléculaire. Ce’tag’ indique aux ILC3, qui sont des résidentes transitoires dans l’intestin, où elles doivent migrer. En l’absence des entrées circadiennes du cerveau, les ILC3 n’ont pas réussi à exprimer ce tag, ce qui signifie qu’elles n’ont pas pu atteindre leur destination.
Selon Veiga-Fernandes, ces résultats sont très excitants, car ils expliquent pourquoi la santé intestinale est compromise chez les personnes qui sont régulièrement actives pendant la nuit.
« Ce mécanisme est un bel exemple d’adaptation évolutive
», explique Veiga-Fernandes. « Pendant la période active de la journée, c’est-à-dire pendant laquelle vous vous nourrissez, l’horloge circadienne du cerveau réduit l’activité des ILC3 afin de favoriser un métabolisme lipidique sain. Mais alors, l’intestin pourrait être endommagé lors de l’alimentation. Une fois la période d’alimentation terminée, l’horloge circadienne du cerveau ordonne aux ILC3 de revenir dans l’intestin, où elles sont alors nécessaires pour lutter contre les envahisseurs et favoriser la régénération de l’épithélium.
»
« Il n’est donc pas surprenant, poursuit-il, que les personnes qui travaillent la nuit puissent souffrir de troubles intestinaux inflammatoires. Cela est dû au fait que cet axe neuro-immunitaire spécifique est si bien régulé par l’horloge du cerveau que tout changement dans nos habitudes a un impact immédiat sur ces cellules immunitaires importantes et anciennes.
»
« Cette étude s’ajoute à une série de découvertes révolutionnaires produites par Veiga-Fernandes et son équipe, qui établissent de nouveaux liens entre le système immunitaire et le système nerveux.
»
« Le concept selon lequel le système nerveux peut coordonner la fonction du système immunitaire est entièrement nouveau. Ce fut un voyage très inspirant ; plus nous en apprenons sur ce lien, plus nous comprenons à quel point il est important pour notre bien-être et nous attendons avec impatience de voir ce que nous trouverons ensuite
», conclut le chercheur.
Pour plus d’informations sur les rythmes circadiens et la santé, voyez les liens plus bas.
Psychomédia avec sources : Champalimaud Centre for the Unknown, Nature.
Tous droits réservés